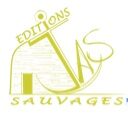Éric Chassefière a participé au Festival de poésie de la foi de Montpellier et alentours. Il a présenté son recueil « Le jardin est visage », le vendredi 21 mars à 17h. Voici le texte de son interview par Jacqueline Assaël.

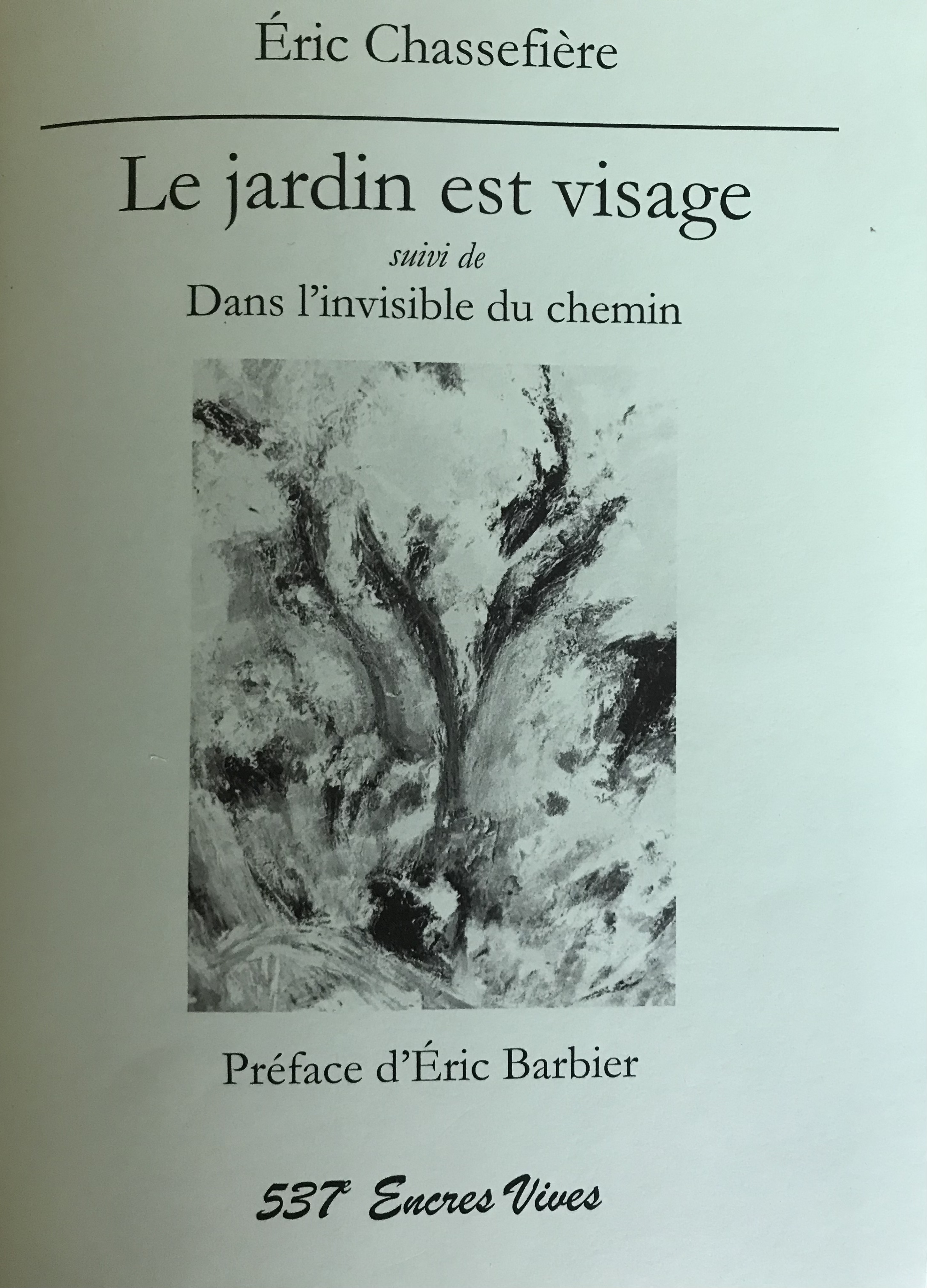
- On aborde forcément votre recueil en premier lieu à travers la très belle formule de son titre: « Le jardin est visage ». En elle-même, cette expression suggère une forme de symbolisme. Est-il question d’un reflet entre la nature et l’humain?
Oui, je pense qu’on peut dire cela. Je n’analyse pas quand j’écris, je m’assieds et je me laisse pénétrer par le paysage en sorte que c’est le paysage qui finit par parler à travers moi. L’écriture est alors acte d’écoute plus que de parole. Et là, c’est peut-être en effet le jardin qui me parle, non seulement par sa voix, mais à travers tous les traits du visage qui s’en dessine dans le miroir de l’humain. Le jardin en quelque sorte se fait miroir, reflétant en l’enrichissant des mille couleurs de la mémoire le visage d’aujourd’hui, qui se fait visage de toute une vie. Une vie de jardin à jardin, car je suis né littéralement dans un jardin, celui du mas provençal de ma prime enfance enchanté de mistral, et m’installant à Frontignan, après une vie passée à Paris, un nouveau jardin, mais toujours habité du même mistral, qui lui prélude à l’accomplissement final. Le jardin qui clôt, et ouvre en même temps. Une redécouverte en quelque sorte.
- Ceux qui vont découvrir votre recueil, par exemple lors du Festival de poésie de la foi de Montpellier, doivent-ils s’attendre, de la part de l’auteur, à une simple évocation de la nature ou, aussi, à une sorte de méditation intérieure sur l’évolution de sa propre personnalité et donc de son propre être, s’il est vrai, comme le dit Camus, « qu’après un certain âge, tout homme est responsable de son visage »? (Nous verrons ensuite, je crois, que du temps s’écoule au long de l’écriture, c’est pourquoi je m’autorisais cette idée d’évolution. Vous nous direz si elle est pertinente.)
C’est vrai qu’avec l’âge venant, et la santé étant heureusement toujours là, et par ailleurs ayant changé de monde, puisque la retraite arrivant je suis passé du monde de la recherche en sciences dures à celui de l’écriture poétique, je me trouve dans une nouvelle configuration, libéré des contraintes du quotidien professionnel, à me chercher un nouveau visage, celui de qui contemple la beauté. C’est ce visage-là dont je me sens responsable, ce visage reflétant la beauté qu’il contemple, celle de ce jardin notamment, mais pas uniquement, celle aussi des personnes qui m’entourent. Je suis clairement dans une quête de beauté et d’amour, c’est cette quête je crois, quête de soi-même et de l’autre à travers soi-même, qui constitue le fil conducteur de Le jardin est visage. Il y a bien me semble-t-il cette idée d’évolution que vous mentionnez. Une nouvelle jeunesse à rejoindre, dirais-je, en sorte d’accomplir une vie, en devenir la courbe, naître et mourir d’un même geste. Un but quelque peu idéal bien sûr, mais qui au moins constitue un guide dans cette dernière partie de ma vie.
- Et si le jardin n’est pas seulement nature, mais aussi culture, puisqu’il « faut cultiver notre jardin », est-ce que le déploiement de l’ensemble du recueil esquisse la progression d’un travail sur soi-même, ne serait-ce que pour parvenir à une connaissance de soi?
Oui absolument, c’est ce que je viens de décrire. C’est une nouvelle amitié avec le monde que je voudrais savoir installer et cultiver. Une connaissance de soi ? Je ne sais pas trop. Ce n’est pas tellement à me connaître mieux que je voudrais employer mes forces, car peut-on jamais se connaître dans sa complexité, et d’ailleurs à quoi cela servirait-il, plutôt à infléchir mon rapport au monde dans le sens de plus de bonheur, plus de joie d’être au monde. Je crois en la beauté, et au pouvoir des mots pour en rehausser l’intensité, tout comme en voyage écrire des poèmes confère aux lieux visités une beauté qu’ils n’avaient pas naturellement. Cultiver les mots comme on cultive un jardin, pour que les fleurs en soient plus belles.
- Pour des Chrétiens, la contemplation du Visage, correspond à un effort de correspondance avec l’image du Christ. On le voit notamment dans un passage quasiment mystique de l’Épître de Jacques, dans le Nouveau Testament, où l’auteur dépeint le croyant comme quelqu’un qui contemple son visage originel dans un miroir et cherche à s’y fondre » (1, 23-25).
J’ai la religion de la beauté, c’est ce que j’essaie de toucher par l’écriture poétique. C’est dans ce sens peut-être que je suis « croyant », quelqu’un en effet qui contemple son visage originel dans un miroir – le jardin – et cherche à s’y fondre, faire Un en quelque sorte avec la Vie. Car la poésie, c’est la vie n’est-ce pas ? Et c’est bien la raison pour laquelle j’ai accepté votre invitation à ce festival, moi qui profondément ne crois pas en Dieu.
- Je crois qu’on peut dire, que dans votre écriture, un recueil de poésie se déploie comme une construction globale. Il ne s’agit pas simplement de lire des pages détachées. Dans ce cas, comme vous avez attiré mon attention sur le nombre de poèmes contenu dans votre recueil et que vous signalez dans plusieurs interviews qu’il se compose de cinquante textes, ce nombre a-t-il une signification particulière pour vous, réalisant en quelque sorte la complétude d’une démarche poétique ? Chez Pythagore ce nombre met en relation le Microcosme et le Macrocosme, or certaines de vos interviews montrent qu’il s’agit là d’un thème qui vous est cher (« mais c’est vrai que dans ma poésie, je fais de l’arbre un cosmos, de l’infiniment petit un infiniment grand » Entretien et présentation réalisés par jean-paul gavard-perret, pour lelitteraire.com, le 10 août 2024); par ailleurs, dans la kabbale, il est question des cinquante portes de l’intelligence; dans la Bible ce chiffre est celui de la joie et de la fête; dans les mythes antiques celui de l’abondance et de la prospérité… Est-ce que l’attention à cette construction de votre recueil peut enrichir la lecture en nous incitant à déceler dans chaque texte une porte vers le sens du monde ou dans chaque poème une représentation condensée de l’infini de l’univers ?
Le nombre de 50 est fortuit, lié à la contrainte des 32 pages au format A5 pour Encres Vives. Aucune intention donc.
- Pour situer encore votre démarche d’écriture, sur un autre plan, par des indications biographiques, ai-je bien lu vos interviews en comprenant que le jardin en question est celui d’un mas familial où vous vous êtes ressourcé tout au long de votre jeunesse en particulier ?
Non, ce jardin est le nouveau jardin, pas celui de naissance, mais il est vrai que je tente ici, comme je l’ai dit, la fusion de ces deux jardins.
- Pour éclairer indirectement les textes, peut-être pouvez-vous développer l’idée d’un écho ou d’une influence entre l’œuvre d’Andreï Tarkovski et ce recueil qui lui est dédié. Vous faites souvent référence, en particulier, au film Le Miroir. Pour ceux qui ne le connaissent pas, pouvez-vous expliquer quelles émotions particulières il suscite en vous et ce que nous pouvons peut-être en retrouver ou ce que vous aimeriez que nous en retrouvions dans votre recueil?
J’ai découvert ce film il y a longtemps, à sa sortie, et ne l’ai pas revu récemment. J’en garde plus des impressions que des souvenirs précis. Il a pour moi incarné la révélation du mystère de l’être, sur le fond de la musique de la Passion selon Saint-Jean de Jean-Sébastien Bach, une musique qui m’a toujours fait frémir. Pasolini aussi utilise la musique des passions de Bach, dans Accatone par exemple, une musique pour moi réellement cosmique, qui transcende le temps et l’espace. Les films de Tarkovski, et celui-ci en particulier, sont un miroir dans lequel on est susceptible de se découvrir soi-même, à la façon de ce jardin aux traits patiemment éclaircis qui constitue la trame de mon recueil. Beaucoup d’images fortes dans ce film, la présence du vent, comme cette vague de l’herbe d’été accompagnant vers le début le pas du médecin arrivant dans la propriété, ou de ces objets renversés sur la table du jardin, tandis qu’une main invisible – celle de l’ange ?- semblent venir effleurer la haie, la pénombre baignant la maison d’enfance, la carafe de lait renversée sur la table, dans la pénombre, blanc sur noir, le visage de l’enfant dans le miroir se muant en un autre, le visage aimé si je me souviens bien, cette façon de filmer, comme au ralenti, une façon peut-être de faire ressortir la profondeur de la mémoire ; quelquefois d’ailleurs les temps se rejoignent si je me souviens bien, la fille rencontre dans un jardin la mère qu’elle sera. Tout dans ce film est à la fois de l’ordre du souvenir et de la prémonition. On est comme hors du temps, on voit dans le miroir sa vie dans son entier. Et les poèmes d’Arseni Tarkovski, lus par son fils, renforcent encore le mystère.
- À propos de la composition du recueil, je m’interrogeais sur la possibilité de considérer chaque poème comme une porte sur l’intelligence du sens. En même temps, si l’on observe les textes, on voit qu’ils reprennent souvent les mêmes éléments: lumière, substance des feuilles, murmure d’un oiseau, etc., avec des changements quasiment insensibles, comme des glissements qui font néanmoins avancer dans le temps. Pourrait-on dire que vous procédez en quelque sorte par tuillage pour suggérer une espèce de permanence des formes essentielles du monde?
Il y a bien dans ces poèmes l’idée d’une permanence, d’une nature s’auto-engendrant, dont je tente de traduire par la luxuriance des mots et leur répétition l’incessante métamorphose en elle-même. Je ne sais si cela répondra précisément à la question, mais cela me donne envie de vous lire un extrait de la chronique, intitulée : « Le jardin est visage, ou la rumeur du monde », consacrée à mon recueil sur le site de L’altérité par Hervé Rostagnat, où il est question de Dieu et du grand Tout :
« Dans « Le jardin est visage », tout est questionnement. La beauté du jardin est métaphore du cosmos, profond comme la fleur à moins que la fleur n’en soit la représentation microcosmique. Le jardin est corps. Il est yeux, mains, lèvres, peau, cœur, sang. Il est la beauté. Il est l’indicible. Et comment traduire l’indicible autrement qu’en cherchant Dieu ? Mais le Dieu d’Éric Chassefière est substance. Appartenir au monde en cette fusion c’est être le monde. Le jardin est nature. L’homme est nature. Nul artefact. Nulle production. Le jardin et l’homme sont substance au sens où ils ne sont le produit de rien, ils ne sont le produit d’aucune intervention extérieure puisqu’une substance est précisément ce qui est en soi et est conçu par soi. L’être est jardin. Le jardin est l’être. L’oiseau nait del’arbre et l’arbre de l’oiseau. Dieu est substance au sens où nul ne peut dire que Dieu est une création de l’univers ni que Dieu a créé l’univers. Dieu ne provient de rien.
Ainsi peut-on dire qu’il n’y a rien de transcendantal dans la poésie d’Éric Chassefière. Tout est immanence : « immanence de la source… immanence de ce chant… tout se cache en tout… tout vient s’y lire en tout ». Les 55 occurrences du mot « tout » suffisent à montrer, combien dans cet englobement, la nature s’engendre d’elle-même. Elle est incréée. L’Être n’est-il pas alors que dans cette contemplation ? Dans ce questionnement permanent, le poète considère : étymologiquement, il a le nez dans les étoiles. Il y a quelque chose de sidéral dans cette attention qui constitue une forme d’ontologie de l’homme, une sorte d’ontologie extrême au sens où il n’y a d’homme que s’il y a cette extrême attention. »
- D’Homère à Jean-Jacques Rousseau, par exemple, l’évocation du jardin devient un topos littéraire visant à célébrer les délices de la nature et un lieu d’accomplissement possible de l’humain. Votre jardin est-il paradisiaque? En quel sens? Celui d’une spiritualité matérialiste? Je pense par exemple à l’expression: « comme la substance brille de soi » (p. 3).
Je vous rejoins sur cette idée d’une spiritualité matérialiste. Je cherche par les mots à caresser, ma démarche est sensuelle, proche du corps et plus généralement de la substance. Le jardin est corps, le poème est corps. Corps que je fais corps de mots sur la page. Il s’agit bien de toucher par les mots, donner vie du geste de toucher, finalité ultime de celui d’écrire. En cela le geste d’écrire est pour moi fondateur. J’ai écrit, dans un entretien avec Clara Régy, qui date de quelques années :
« La poésie est avant tout pour moi un acte de vie. J’ai besoin d’écrire pour me sentir vivant, tisser un lien charnel avec le monde. Un désir d’appartenance, qu’on pourrait qualifier d’amoureux. J’ai longtemps écrit exclusivement dans la nature, l’été, sur le lieu d’enfance, submergé par le sentiment d’une beauté dépassant mon entendement, que par les mots je tentais d’atteindre et me réapproprier. Il y avait déjà ce plaisir sensuel à faire naitre les mots du corps, de sa vibration profonde, faire corps du poème, entendre et ressentir à travers lui. C’est ainsi qu’est né mon désir d’écrire, retrouver sous la caresse des mots l’enfance perdue, mon jardin d’Eden. »
Il y a donc bien une aspiration à retrouver un paradis perdu, vous avez vu juste, et peut-être ce recueil vient-il précisément concrétiser, voire accomplir, cette aspiration à retrouver une origine, à en faire le berceau d’une vie nouvelle, réunifiée, qui nous place en situation d’accueillir la mort, entrer dans ce jardin, « dont l’ange a refermé les portes sans retour », pour reprendre le final du poème de Bonnefoy placé en exergue.
- Pourquoi le jardin est-il en général symbole de la sécurité? Pour vous, s’agit-il d’un lieu clos ou ouvert sur le monde? Pourrait-on dire que votre jardin est un lieu de paix?
Pour moi le jardin, c’est avant tout le chant du mistral dans le feuillage des platanes du jardin, au profond de mes nuits d’enfance, c’est en quelque sorte le berceau, le souffle dont je suis né. Donc oui, il est porteur d’une certaine sécurité, je m’y sens bien. Ce lieu est ouvert sur le monde, comme peut l’être l’enfance. À l’horizon du jardin d’enfance, il y a les montagnes des Baux de Provence d’un côté, celles de la Montagnette de l’autre, et je rêve alors souvent, aux portes du jardin s’ouvrant dans la haie, de franchir leurs lignes de crête. Oui, dans ce jardin d’enfance, je rêve d’avenir, il est ouvert sur le monde. En même temps, il y a cette roubine qui délimite la propriété en en faisant le tour, roubine qu’enfant je ne peux franchir en l’absence de pont, et le monde n’est ouvert qu’à mon regard. C’est par le regard que j’investis l’horizon, comme plus tard, revenant chaque été en ce lieu, je l’investirai par les mots, car mon pas sera devenu celui des mots. Lieu de paix, ce jardin d’enfance ? Pas vraiment, lieu chargé des souffrances familiales, dont précisément je m’évade enfant par le regard, puis, adolescent et adulte, par la poésie. Lieu d’envol, lieu du cri fondateur, dont toute ma vie je suivrai l’écho…